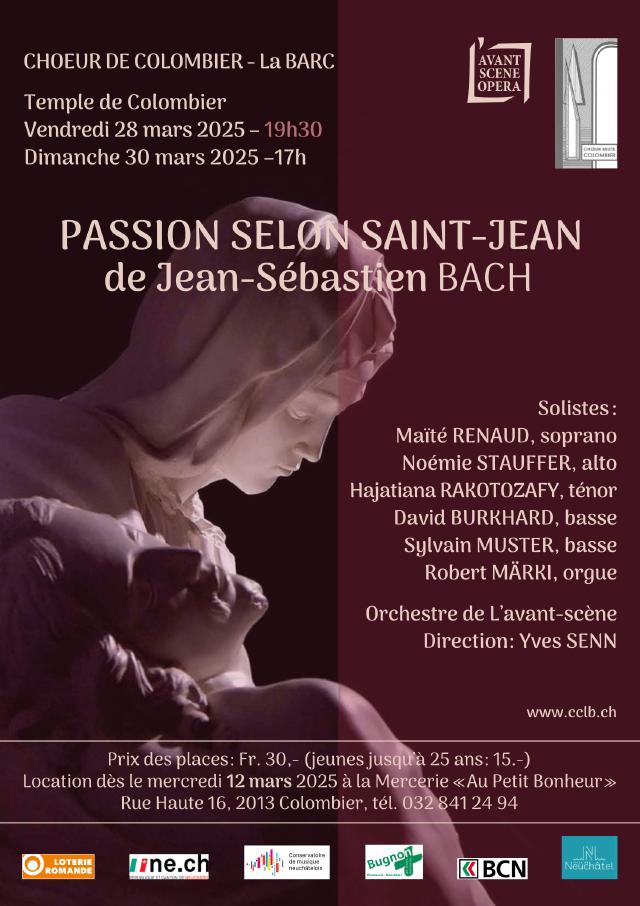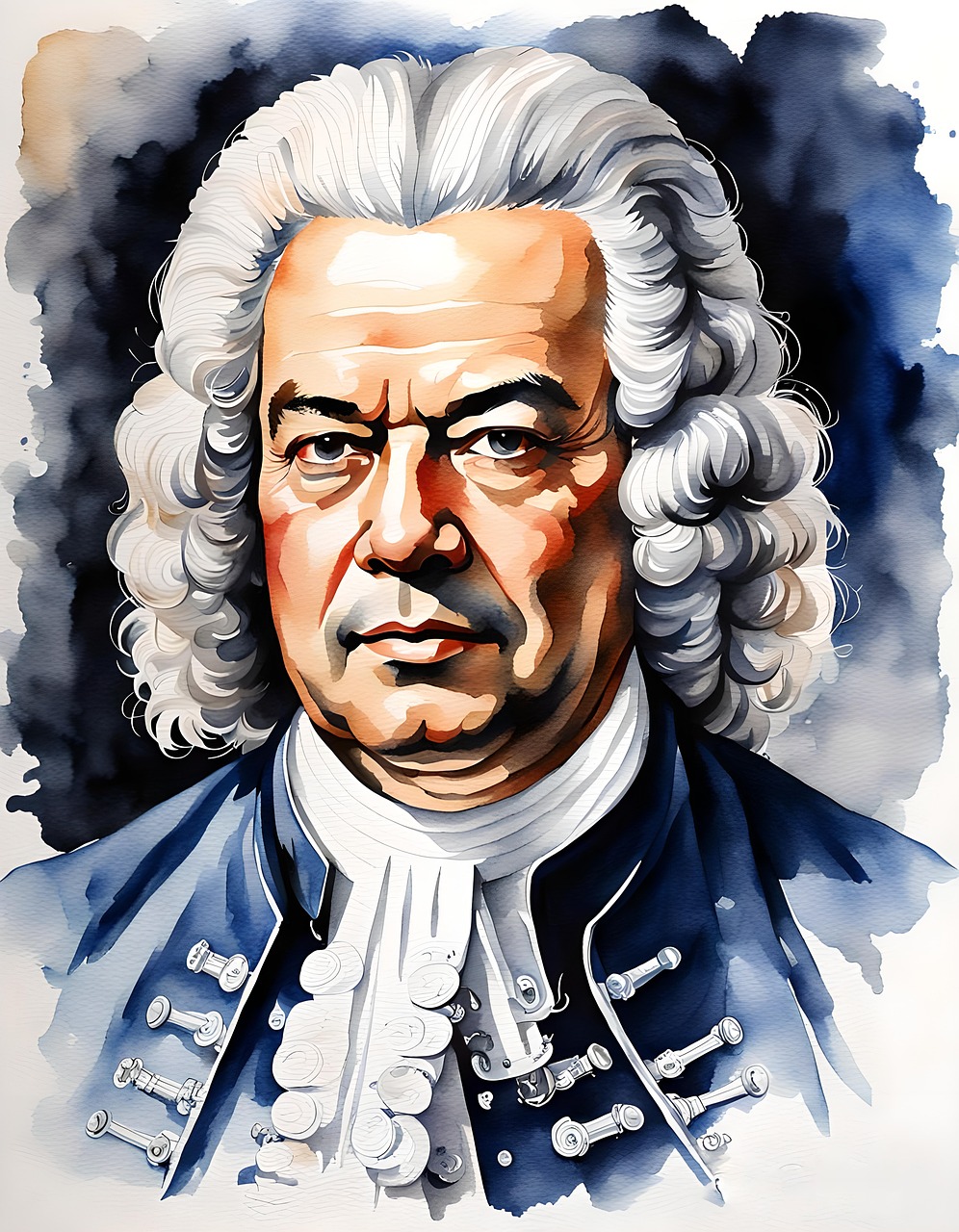Ce week-end, le Chœur de Colombier – La BARC proposera au public l’œuvre magnifique de Jean-Sébastien Bach Johannes-Passion. Durant la préparation de ce concert, il m’a été donné d’introduire succinctement l’œuvre auprès des chanteurs et des chanteuses. Je partage ici ces quelques éléments qui donneront peut-être aussi quelques clés à celles et ceux qui viendront nous écouter.
Quelques bases pour commencer
Pour commencer, il convient de rappeler le sens du mot Passion puisque nous n’utilisons plus ce terme de la même manière dans le langage courant. Passion vient du verbe latin patior qui signifie souffrir. La Passion est le récit des souffrances du Christ. Et il ne s’agit pas de n’importe quelle Passion, mais la Passion selon Jean. L’œuvre suit très précisément le récit des derniers jours de Jésus tels qu’ils sont racontés dans l’évangile de Jean.
On connaît aussi la St Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Et on a retrouvé des passages d’une St Marc et St Luc mais la grande partie de ces œuvres est aujourd’hui perdue.
Au Moyen Âge déjà, il était commun de chanter le récit de la Passion durant la semaine sainte et en particulier le jour de Vendredi saint. On dit que le compositeur Telemann en aurait composé une cinquantaine.
Jean-Sébastien Bach (1685-1750), alors Cantor de l’église St-Thomas de Leipzig, s’inscrit dans cette tradition et compose la Passion selon St-Jean pour la célébration de Vendredi saint le 7 avril 1724.
Trois dimensions de l’œuvre
On peut relever trois dimensions distinctes de l’œuvre.
La première, la dimension didactique. Les différents passages chantés suivent strictement la lecture du récit biblique avec une grande fidélité au texte. Il s’agit des chapitres 18 et 19 de l’évangile de Jean dans sa version allemande, c’est-à-dire dans la traduction faite par le réformateur Martin Luther lui-même. L’œuvre se présente donc comme un récit chanté et permet à l’assemblée de se remémorer le récit ou de le découvrir. Nombreux étaient sans doute les auditeurs qui connaissaient le texte presque par cœur à force de l’entendre lire chaque année depuis leur enfance. Il ne faut pas non plus oublier que tout le monde ne savait pas lire à l’époque.
La deuxième dimension est la dimension liturgique de l’œuvre. Il ne s’agit pas d’un concert mais bien d’un culte. L’assemblée vient célébrer le Vendredi saint et le pasteur intervient à certains moments de la liturgie.
La troisième dimension est théologique. L’œuvre contient en elle-même des éléments d’interprétation et d’actualisation. On ne se contente pas de raconter les derniers jours de la vie de Jésus, on proclame aussi leur répercussion dans la foi pour les chrétiennes et les chrétiens.
Les personnages
Ces dimensions sont amenées par les différents intervenants. Les chanteurs et les chanteuses incarnent les personnages du récit.
L’évangéliste est le narrateur. Il reprend fidèlement les parties narratives des chapitres 18 et 19 de l’évangile de Jean et introduit les prises de parole des personnages: Jésus, la servante, Pierre, Pilate, etc. Ces personnages sont incarnés par les solistes qui chantent parfois de très courtes phrases qui s’intègrent dans le récit du narrateur-évangéliste, comme des dialogues.
La foule est incarnée par le chœur qui chante les parties intitulées Coro. C’est un personnage fondamental du récit qui fait avancer l’intrigue de manière majeure. La foule joue un rôle terrible, elle crie, appelle à la haine, à la violence et à la mort. Il est important de se souvenir, lorsque l’on chante la St-Jean, et même si la musique est magnifique et que l’on a envie de la rendre belle, que le chœur chante des choses terribles.
Rôles du chœur
Le chœur incarne donc un personnage collectif du récit: la foule. Mais il a aussi un autre rôle dans la Passion selon St-Jean.
Dans la dimension liturgique, le chœur se fait le chantre des croyantes et des croyants. Il ponctue régulièrement le récit de chorals, des cantiques qui viennent rappeler que l’on n’assiste pas à un concert mais que l’on vit une célébration. Ces cantiques étaient des mélodies connues à l’époque. Elles étaient régulièrement chantées lors des cultes. C’est encore le cas de plusieurs de ces cantiques qui figurent dans nos recueils de chants actuels et que nous entonnons volontiers le dimanche.
Ces chorals se trouvent intégrés au récit de la Passion dans la célébration de Vendredi saint et permettent d’exprimer la foi des croyants et des croyantes face à la Passion du Christ. Par ceux-ci, des liens sont faits avec la souffrance des êtres humains, les tourments de la vie, la reconnaissance des péchés, la confiance dans le Christ. Et à la toute fin de l’œuvre, une ouverture sur l’espérance de la Résurrection.
La St-Jean est divisée en deux parties dans lesquelles s’intègrent des chorals.
La première partie reprend le récit de Jean 18,1-27 (arrestation de Jésus, face-à-face avec le Grand prêtre, reniement de Pierre) et se termine par le chant du coq.
La seconde partie reprend le récit de Jean 18,28 à 19,42 (Jésus devant Pilate, condamnation à mort, crucifixion, mort et mise au tombeau).
Entre ces deux parties, prenait place le sermon (ou prédication) du pasteur. La première partie se termine par un choral, la seconde débute par un choral. Ainsi dans la version concert, deux chorals se suivent mais initialement, ils encadraient une intervention du pasteur dont on ignore la longueur.
La dimension théologique de l’œuvre est exprimée par les airs (aria) des solistes ainsi que deux interventions du chœur qui ouvrent et ferment l’œuvre. Bach avait l’interdiction d’écrire de l’opéra et on peut soupçonner que les aria étaient pour lui l’occasion d’écrire des airs lyriques pour des solistes. Ces airs permettent d’intégrer dans le récit et la célébration une interprétation actualisante de la Passion.
Le chœur d’ouverture proclame sans détour Seigneur notre souverain! Ce à quoi nous allons assister est le récit de l’extrême abaissement dans lequel paradoxalement le Christ est glorifié. Le chœur de clôture prend place juste avant le dernier choral, comme une prière: repose en paix, le tombeau nous ouvre le ciel.
Ainsi le chœur tient un rôle important dans la partie didactique de l’œuvre, en tant que personnage collectif: la foule. Il est le chantre les croyants et des croyantes dans la dimension liturgique et participe, avec les solistes par leurs airs, à la dimension théologique en proclamant la gloire du Christ par sa mort et sa Résurrection.
En concert
En espérant que ces quelques éléments nous permettrons peut-être de mieux saisir la force de l’œuvre et vous donnerons peut-être envie de l’écouter.
Le Chœur de Colombier-La BARC donne deux concerts: vendredi 28 mars à 19h30 et dimanche 30 mars à 20h00 au temple de Colombier. Il reste quelques places, à réserver à la Mercerie « Au petit Bonheur », rue Haute 16 à Colombier 032 841 24 94 ou sur place les jours des concerts.