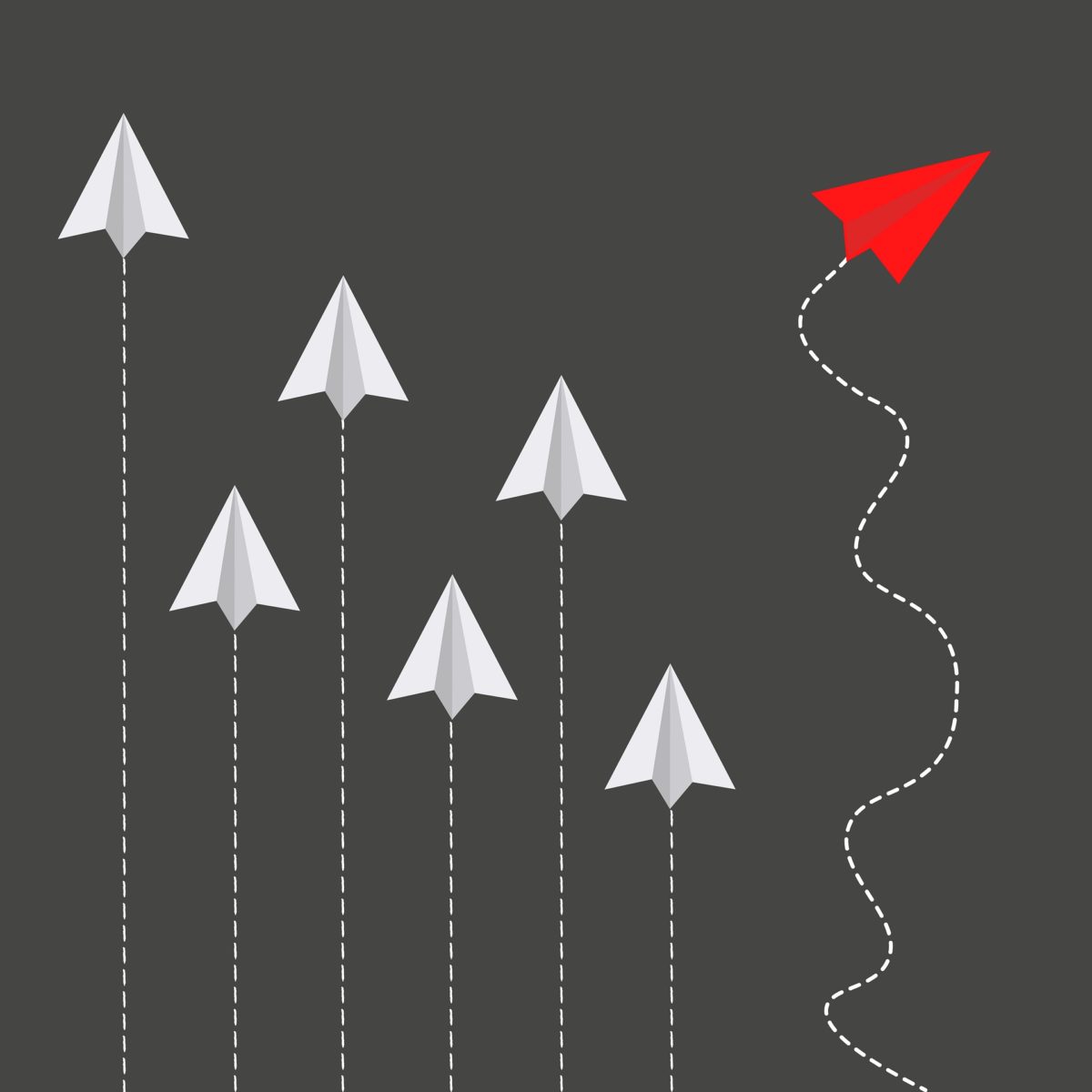Deux femmes expriment leur demande face à un homme. L’une, Anne, est plutôt discrète, effacée, alors qu’une femme anonyme de l’évangile de Marc surprend par son audace.
Voici tout d’abord le récit qui nous parle d’Anne :
Il y avait un homme de Ramataïm-Tsophim, de la région montagneuse d’Ephraïm, nommé Elqana, fils de Yeroham, fils d’Elihou, fils de Tohou, fils de Tsouph, Ephratite,
1 Samuel 1,1-18
qui avait deux femmes. Le nom de l’une était Anne et le nom de la seconde Peninna ; Peninna avait des enfants, mais Anne n’en avait pas.
Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant le SEIGNEUR (YHWH) des Armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d’Eli, Hophni et Phinéas, prêtres du SEIGNEUR.
Le jour où Elqana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Peninna, ainsi qu’à tous les fils et filles de celle-ci.
Mais il donnait à Anne une part d’honneur ; car il aimait Anne, bien que le SEIGNEUR l’eût rendue stérile.
Sa rivale ne cessait de la contrarier, parce que le SEIGNEUR l’avait rendue stérile.
D’année en année il faisait ainsi, et chaque fois qu’Anne montait à la maison du SEIGNEUR Peninna la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas.
Elqana, son mari, lui dit : Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il triste ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils ?
Après qu’ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Eli, le prêtre, était assis sur son siège, près du montant de la porte du temple du SEIGNEUR.
Elle, amère, se mit à prier le SEIGNEUR et à pleurer abondamment.
Elle fit un vœu, en disant : SEIGNEUR (YHWH) des Armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m’oublies pas, si tu me donnes une descendance, à moi qui suis ta servante, je le donnerai au SEIGNEUR pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête.
Comme sa prière se prolongeait devant le SEIGNEUR, Eli observait sa bouche.
Anne parlait dans son cœur ; seules ses lèvres remuaient, mais on n’entendait pas sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre.
Il lui dit : Jusqu’à quand resteras-tu ivre ? Va cuver ton vin !
Anne répondit : Mon seigneur, je ne suis pas une femme entêtée, et je n’ai bu ni vin ni boisson alcoolisée ; je me répandais devant le SEIGNEUR.
Ne me prends pas, moi, ta servante, pour une femme sans morale, car c’est l’excès de ma douleur et de ma contrariété qui m’a fait parler jusqu’ici.
Eli répondit : Va en paix ; que le Dieu d’Israël te donne ce que tu lui as demandé !
Elle dit : Je suis ta servante ; que je trouve toujours grâce à tes yeux ! Puis elle repartit. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même
Et maintenant le récit qui nous parle de cette femme dont on ne connaît pas le nom, juste son origine : elle appartient au peuple Phénicien vivant en Syrie.
Jésus passa par le territoire de Tyr. Il entra dans une maison ; il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché.
Marc 7,24-30
Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds.
Cette femme était grecque, d’origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille.
Il lui disait : Laisse d’abord les enfants se rassasier, car ce n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens.
Mais elle lui répond : Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants…
Il lui dit : A cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille.
Quand elle rentra chez elle, elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti.
Pourquoi faire un parallèle entre ces deux femmes ?
Les deux récits sont structurés de manière semblable :
1) les protagonistes sont des femmes ;
2) chacune trouve en face d’elle un homme qui cherche à la renvoyer (le grand prêtre Eli pour Anne, Jésus pour la Syro-phénicienne ;
3) grâce à une réponse adéquate, chacune d’elle obtient ce qu’elle désirait.
Centrons-nous sur la femme audacieuse.
Le dialogue met en valeur le fait que la femme est toujours le personnage actif ; en effet, une réponse nécessite une question, une quête et, ici, c’est la Syro-phénicienne qui, dans un sens, mène le débat. Elle pousse Jésus à prendre une attitude qu’il ne semblait pas avoir envisagée au début du dialogue, et elle fait cela grâce à un jeu habile de vocabulaire.
Suivons le récit pas à pas. Chez Marc, Jésus entre dans une maison du territoire de Tyr (donc à l’étranger) et désire séjourner là incognito, mais il ne peut rester ignoré. Sa réputation l’a devancé et une femme a entendu parler de lui.
Matthieu ajoute ici que Jésus ne répond pas à sa demande de guérison pour sa fille, et que cette femme crie derrière le groupe des disciples. Ceux-ci demandent à Jésus de la « délier » (comme on détache un animal, notamment un chien). Le verbe est à double sens : la « renvoyer », ou la « libérer » ; l’ambiguïté subsiste.
Jésus répond à la femme : « Lasse d’abord les enfants se rassasier, car ce n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Nous, lecteurs, sommes sont très surpris de ce qualificatif rabaissant, à la limite de l’injure ! Notons que la traduction « petits chiens » – souvent présentée comme un adoucissement – n’est peut-être pas la bonne. Il est possible que le terme renvoie aux « chiens de la maison », aux « chiens domestiques ». Dans cette optique, Jésus oppose à la femme une fin de non-recevoir, mais il ouvre une brèche que celle-ci saura exploiter.
En effet : « Assimilée […] par celui qu’elle supplie à un kunarion, la femme va comprendre qu’elle n’est pas un chien errant et irrécupérable, elle est, certes, une païenne, assimilable à un chien, mais il y a place pour elle dans la maison. » (J.F. Baudoz, Les miettes de la table, cité par Christiane Nani). Dans sa réponse, la Syro-phénicienne revient sur les « miettes » (petitesse de la demande), mais précise que celles-ci tombent de la table (naturellement, sans besoin d’action particulière).
Disant cela, elle tient bon, tout en contournant la difficulté. « Elle ne contourne pas la vérité, elle contourne l’appartenance pour infiltrer le cas de sa fille dans le souci de cet homme », comme l’écrit Marion Muller-Colard (Le complexe d’Elie, p. 108-109). Et cette auteure continue : « Retournement. Conversion de Jésus de Nazareth. Conversion d’un prophète juif en Fils de l’homme. »
Les deux évangiles concluent : « A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille » (Marc) et « Femme, ta foi est grande ! Qu’il t’arrive comme tu le veux ! » (Matthieu).
La Syro-phénicienne est habile. Certains parleraient de manipulation (reproche très à la mode aujourd’hui). Nous ne nous attarderons pas trop là-dessus… Mais dans le même évangile on trouve, évidemment, Hérodiade et Salomé (Marc 6,17-29).
Le texte fait apparaître les désirs contradictoires dans lesquels Hérode s’est enfermé. Il veut tout à la fois, la femme de son frère et la parole du prophète à écouter. Il vit avec une femme qui veut se débarrasser de celui qu’il « préserve » après l’avoir fait enfermer. L’impasse dans laquelle Hérode lui-même s’est enfermé est patente : il est perplexe, littéralement en état « d’aporie » (il était embarrassé). Cette situation ne peut pas durer, écrit Camille Focant, elle doit évoluer.
C’est le monde de la manipulation (la mère), de la séduction (la fille et sa danse), le fait de se trouver « sous influence » (la fille par rapport à sa mère dominatrice). Le roi lui-même est enchaîné par son serment. Monde du paraître et des intrigues, monde du faste et du désir de puissance – un monde où la liberté n’existe pas et ne peut pas exister.
Par sa manigance, Hérodiade emprisonne littéralement Hérode dans son serment, et cela devant ses invités (dignitaires, officiers, notables). La femme syro-phénicienne obtient ce qu’elle désire (la guérison de sa fille) d’une manière très différente : elle entraîne Jésus à un retournement complet par une simple parole, qui la montre humblement disposée à consentir au rôle que Jésus lui assigne. D’un côté, l’enchaînement qui conduit à la mort ; de l’autre, la liberté et la confiance récoltant la vie.
Concluons :
- A mon sens, tous les chrétiens se doivent de revendiquer cette entière liberté que procure le Christ, liberté qui est incompatible avec la pression et la manipulation sous toutes ses formes.
- Cette liberté est appelée à se vivre dans l’offrande et le don de soi.
- Elle rejette toute discrimination, toute appartenance qui pourrait se révéler paralysante.
- Au-delà des particularismes, les chrétiens sont appelés à accéder à une identité nouvelle. Car « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Corinthiens 3,17).
Image par Rosy – The world is worth thousands of pictures de Pixabay